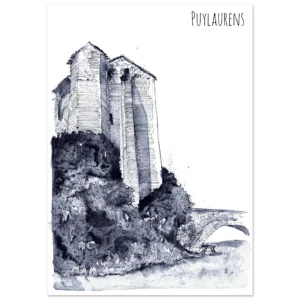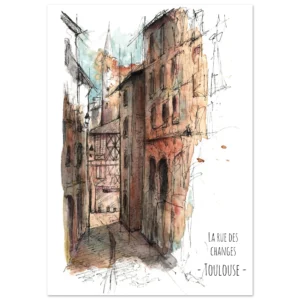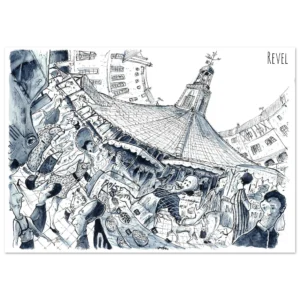Obtenir des pigments bleus à partir de la plante d'indigo

Qu'est-ce que l'indigo ?
Le nom « indigo » fait référence à une substance organique qui est extraite des plantes à indigo et qui, après diverses manipulations chimiques, permet d’obtenir ce fameux bleu « indigo ».
Les plantes à indigo ne possèdent pas naturellement de colorant ou pigment bleu à proprement parler, mais des précurseurs nommés indican ou isatan B et isantan B. Une fois ces précurseurs obtenus, il faut les transformer pour obtenir le fameux pigment.
Il existe environ une centaine d’arbustes et de plantes à indigo, mais seulement une dizaine sont réellement utiles pour en extraire les pigments.
L'indigo dans l'histoire
Avant que les chimistes, notamment ceux du 19ᵉ siècle, ne s’emparent de la fabrication du bleu, cette couleur était rare à l’état naturel. Bien que des pigments minéraux comme le lapis-lazuli fussent déjà connus, leur obtention était difficile et ils étaient principalement localisés dans quelques régions restreintes de la planète, principalement en Afghanistan, ce qui en faisait un pigment rare et extrêmement cher. C’est donc principalement grâce à la maîtrise de l’extraction des colorants issus des plantes à indigo que l’on a pu obtenir cette couleur.
Les premières traces retrouvées de la culture de l’indigo remontent à environ 4 000 ans avant notre ère en Inde. Les Mésopotamiens et les Égyptiens de l’Égypte ancienne maîtrisaient aussi la culture de cette plante, puisque des traces ont été découvertes datant d’environ 2 500 ans avant J.-C. La première apparition de l’indigo dans un ouvrage date de 77 après J.C. dans le livre « De materia medica » écrit par le médecin, pharmacologue et botaniste grec Dioscoride. Les Mayas, de l’Amérique précolombienne, utilisaient l’indigo en le mélangeant à de l’argile palygorskite pour obtenir un bleu proche du bleu primaire, appelé « bleu maya ».
En Europe, c’est une autre plante à indigo qui a fait la fortune de nombreux commerçants, notamment à Toulouse et dans ses alentours : l’Isatis Tinctoria, plus connue sous le nom de Pastel des teinturiers. Au départ, cette plante n’était pas classée dans la famille des indigos, mais des recherches ont prouvé que ses composants sont les mêmes que ceux présents dans les autres plantes de cette famille.
À leur arrivée en Asie au XVIe siècle, les Portugais découvrent que l’indigo est aussi présent et qu’il est vendu sur les marchés sous forme de poudre.


Les particularités des pigments d'indigo:
- Pour obtenir les pigments des plantes à indigo, il faut d’abord extraire ce que l’on appelle les précurseurs. Ce n’est qu’ensuite, après quelques manipulations, que l’on obtient les précieux pigments.
- L’alun n’est pas nécessaire pour transformer le colorant en pigment contrairement à la gaude ou à la garance par exemple.
- Les pigments obtenus sont particulièrement résistants aux rayons UV et aux autres intempéries extérieures.
Les principales plantes à indigo:
Parmi la dizaine de plantes/arbustes pouvant être utilisées pour extraire le pigment d’indigo, trois se distinguent particulièrement :

Indigofera tinctoria
Sans aucun doute la plus célèbre des plantes à indigo, elle est également appelée l'indigo des teinturiers. Originaire d'Inde, elle est réputée pour être celle qui produit la plus grande quantité d'indigo.

Isatis tinctoria
Connue sous le nom de Pastel des teinturiers, cette plante a fait la fortune de certains marchands du Lauragais. Sa couleur était exportée à travers l'Europe avant l'importation massive de l'indigo des Indes et des Amériques.

Persicaria tinctoria
Aussi appelée la renouée des teinturiers, elle est originaire d'Asie orientale. Cette plante s'est très bien acclimatée au climat plus rude de l'Europe, contrairement à sa sœur l'indigofera tinctoria.
La recette
Minimum: 1h30
Facile
Bon marché
Ingrédients
- 200 g de poudre de feuilles d’indigo
- 60 g de blanc de meudon ou de cristaux de soude.
- Du fiel de bœuf liquide (optionnel)
- De l’acide citrique.
Ustensiles

1 cutter

1 filtre en tissu

Filtres à café

1 plaque de polystirène
Plus grande que l'ouverture du récipient !

1 molette
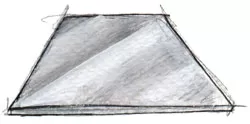
1 plaque de verre

1 crayon

1 spatule en inox ou en plastique
Éviter le fer et les outils oxydés.

2 récipients
Minimum 3 Litres

1 bidon d'eau vide
il doit faire plus de 2 litres

1 entonnoir

1 assiette

1 pissette

1 mixeur
Fabrication du couvercle flottant
Ce couvercle permettra de limiter le contact de l’air avec la préparation, réduisant ainsi le risque d’une oxydation trop rapide.
Étape 1
Posez le récipient tête en bas sur la plaque de polystyrène et dessinez le contour avec un crayon.
Étape 2
Redessinez un cercle à l’intérieur du cercle initial en réduisant le diamètre d’environ 0,5 cm.
Étape 3
Découpez le cercle le plus petit à l’aide d’un cutter.
Étape 4
Vérifiez que le cercle puisse s’insérer dans la partie haute du récipient sans qu’il n’y ait beaucoup d’espace entre les bords.
Étape 5
Si le couvercle ne s’insère pas dans la partie haute du récipient réduisez encore un peu plus sa taille à l’aide du cutter.
Étape 6
Votre couvercle flottant est prêt.
Préparation
Étape 1
Dans le récipient, versez 2 L d’eau tiède (environ 45°C) et ajoutez 200 g de poudre de feuilles d’indigo.
Étape 2
Ajoutez trois gouttes de fiel de bœuf (un agent mouillant) afin d’aider les feuilles d’indigo à absorber l’eau.
Le fiel de bœuf n’est pas obligatoire, mais il facilite beaucoup le travail.
Remuez à l’aide du fouet jusqu’à ce que toutes les feuilles soient mouillées.
Étape 3
Posez le « couvercle flottant » sur la préparation.
À ce stade, il est important de limiter le contact de l’air avec la préparation.
Étape 4
Laissez infuser une heure minimum.
Étape 5
Versez la mixture dans l’autre récipient en filtrant à travers un filtre en tissu pour séparer le liquide des feuilles.
Vous obtenez une solution légèrement jaune/verte.
Étape 6
Ajoutez environ 60 g de blanc de Meudon ou de cristaux de soude dans la solution.
Étape 7
Mixez à l’aide d’un mixeur ou d’un fouet pendant environ 3 minutes.
L’objectif de cette étape est d’incorporer de l’air à la préparation précédente, qui doit mousser et devenir bleue.
Étape 8
Laissez reposer 5 minutes.
Étape 9
Dans l’embouchure d’un bidon d’eau vide, posez l’entonnoir avec un filtre à café à l’intérieur et versez-y lentement la préparation.
Il faut prendre son temps et attendre que la préparation coule du filtre à café pour éviter qu’elle déborde.
Une pâte bleu va se déposer au fond du filtre, ce sont les futurs pigments d’indigo.
Étape 10
Ajoutez 1 grosse cuillère à soupe d’acide citrique et de l’eau très chaude dans la pissette.
Remuez la pissette.
Nettoyez les parois du filtre à café avec le jet de la pissette.
Il faut bien insister!
Si vous n’avez pas de pissette, prenez une petite bouteille d’eau, percez un trou au centre du bouchon, puis remplissez la bouteille avec le mélange d’eau et d’acide citrique. Ensuite, il suffit d’appuyer sur la bouteille pour faire sortir le liquide.
Étape 11
Ouvrez le filtre en papier en déchirant délicatement la partie encollée, tout en veillant à laisser la pâte sur le filtre.
Étape 12
Aidez-vous de la spatule pour faire glisser toute la pâte obtenue sur l’assiette.
Étalez au maximum sur l’assiette.
Étape 13
Laissez sécher le temps nécessaire jusqu’à ce que toute l’eau se soit évaporée.
Cette étape peut être accélérée en passant la pâte au micro-onde.
Pour ne pas brûler le pigment, il faut y aller graduellement. Mettez la puissance du micro-onde au maximum et faites-le fonctionner 2 minutes.
Vérifiez que le pigment ne brûle pas et relancez le micro-onde. Ainsi de suite jusqu’à ce que l’eau se soit entièrement évaporée.
Étape 14
Vos pigments sont presque prêts. Il vous suffit de les broyer finement à l’aide d’une molette sur une plaque de verre (ou de marbre), puis de les conserver dans un bocal hermétique.
Vous pourrez ensuite les utiliser pour fabriquer vos peintures, pastels, craies, etc.
Partagez
Et aussi :

Stages et ateliers
Durant l'année, j'organise divers stages et ateliers pour apprendre à fabriquer ses propres peintures.
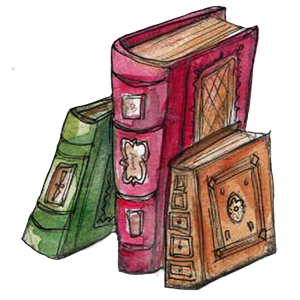
Ressources
J’ai rassemblé des sites, livres et PDF dédiés à la fabrication de peintures, teintures, encres et autres matériaux artistiques.

Boutique
Je mets en vente quelques-unes de mes créations.
Newsletter
En vous inscrivant vous ne recevrez pas de spams de ma part, juste une ou deux newsletters par mois, pas plus.
- ACCUEIL
- À PROPOS
- MES ŒUVRES
- FABRIQUER SES PEINTURES
- Comment fabriquer de l’aquarelle ?
- Comment fabriquer du fusain facilement?
- Comment fabriquer des pigments naturels facilement ?
- Comment fabriquer des pastels secs?
- Comment retendre une toile facilement ?
- Comment fabriquer une encre noire pour la calligraphie?
- Fabriquer de la lessive à la cendre de bois
- Fabriquer de la peinture à la farine
- Fabriquer des pigments bleus avec de l’indigo
- Recette de l’acétate de fer (soupe de clous)
- Fabriquer des cristaux de soude avec du bicarbonate de soude.
- Recette de la laque de garance
- Recette de la laque de gaude
- Fabriquer de la gouache
- Comment fabriquer du brou de noix facilement ?
- Comment fabriquer du carbonate de calcium à la maison?
- Comment fabriquer de la peinture à l’œuf ?
- ATELIERS / STAGES
- RESSOURCES
- FORUM
- LA BOUTIQUE
- CONTACT